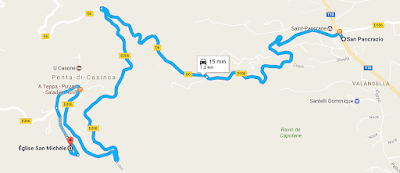Réflexions sur « De l’inégalité parmi les sociétés », de Jared Diamond
Il existe des livres qui apparaissent comme des révélations. Leur lecture affecte notre compréhension de l'histoire, et ne nous laisse aucun choix : certaines de nos convictions tenues jusqu'à présent pour des certitudes s'évanouissent face aux nouvelles vérités. Le lecteur, une fois le volume refermé, songe aux errements qui furent les siens, avant que le brouillard de l’ignorance ne se dissipe. L’évidence paraît dans sa lumière. Jamais plus, se prend-il à penser, sa conception du monde ne sera la même.
L’essai de Jared Diamond, De l’inégalité parmi les sociétés, n’est pas de ceux-ci. Avis bien abrupt, je le concède, au sujet d'une œuvre universellement reconnue pour sa pertinence. Dans les lignes qui suivent, je m'efforcerai d'expliquer pourquoi sa flatteuse réputation paraît partiellement usurpée : mon but ici est de souligner maintes imperfections, qu'accompagnent de bien ténébreuses assertions, relativisant de fait le statut d’incontournable que certains ont décrit.
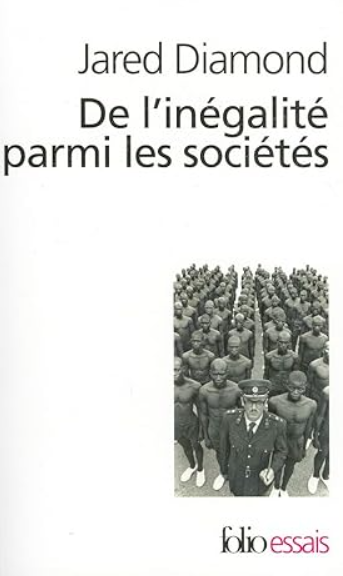 |
| De l'inégalité parmi les sociétés (c) Folio Essais |
Le point de départ est la question que posa un Néo-Guinéen à l’auteur, reformulée ainsi :
« Pourquoi la richesse et la puissance sont-elles distribuées ainsi et pas autrement ? Pourquoi, par exemple, ce ne sont pas les indigènes d’Amérique, les Africains et les aborigènes australiens qui ont décimé, asservi ou exterminé les Européens et les Asiatiques ? » (Prologue, page 4).
J. Diamond rejette avec raison les explications racistes et nous invite à suivre sa réflexion au fil de quatre parties :
« De l’Éden à Cajamarca » survole l’histoire de l’homme depuis la « ligne de départ » commune, il y a environ 13 000 ans.
La deuxième partie, intitulée « L’essor et l’extension de la production alimentaire », s’intéresse à la façon dont les hommes ont domestiqué des animaux et des plantes pour assurer leur subsistance, dans des circonstances variables selon la géographie et les conditions du milieu où ils vivaient.
Dans la troisième partie, « Des vivres aux fusils, aux germes et à l’acier », l’auteur se penche sur le rôle des épidémies, sur les apparitions à divers endroits du globe de l’écriture, de la technologie et de sociétés organisées autour de gouvernements d’institutions étatiques.
La quatrième et dernière partie, « Le tour du monde en cinq chapitres » examine diverses « rencontres » entre hommes issus de civilisations différentes
Dans un épilogue, J. Diamond discute du rôle et de la fonction de l’historien.
Un prologue inquiétant
Allons au but. Le plus fascinant, dans cette somme se voulant un manifeste contre l’interprétation raciste des choses, est précisément la tendance réitérée de l’auteur d’écrire des pensées pour le moins suspectes. Dès la page 2, le lecteur est prévenu :
« Nous savions parfaitement tous deux que les Néo-Guinéens sont en moyenne au moins aussi dégourdis que les Européens. »
Le ton est donné, d’emblée et en toute bonne conscience. Il est donc recevable d’élaborer une analyse sur cette idée bizarre : il existe un taux moyen de dégourdissement de l’ensemble d’une population. Si on tient cette chimère pour vraisemblable, comment l’auteur et son interlocuteur savaient-ils aussi « parfaitement » que cette moyenne penchait en faveur des Néo-Guinéens ? On ne le saura pas. Il s’agit d’une opinion, certainement respectable, qui ne saurait tenir lieu de vérité, tant les concepts qu’elle convoque sont flous et subjectifs.
On se dira que cette réflexion est bien mal formulée — sans doute, Diamond voulait dire ici que rien ne prédispose un natif de Nouvelle-Guinée à être moins fin d’esprit qu’un Européen. Cela, toute personne possédant un minimum du bon sens monde l’admettra, de même qu’elle admettra que l’énoncé de la page 2 a de quoi susciter le scepticisme. Nous n’en parlerions pas davantage si, quelques paragraphes plus loin ne nous était livrée une autre affirmation tout aussi intrigante :
« En réalité, les populations modernes de “l’âge de pierre” sont en moyenne probablement plus intelligentes, non moins, que les populations industrialisées. » (p. 7)
Encore une fois, l’auteur nous parle d’une moyenne, cette fois-ci relative à l’intelligence, et encore une fois, le mauvais élève est « probablement » la population industrialisée. Le lecteur serait prêt à croire une assertion résultant d’une démonstration, ou citant des sources de qualité mesurant l’intelligence parmi ces populations, si une telle chose est envisageable. Chacun reconnaîtra que, sans mesure, aucune moyenne n’est possible. Naturellement, il appartient à celui qui affirme de telles choses de préciser avec rigueur quelles sont les « populations modernes de "l’âge de pierre" » et quelles sont les « populations industrialisées ». Sans ces éléments, nous n’avons pas sous les yeux les travaux d’un professeur d’université distingué, mais une réflexion hasardeuse recueillie au comptoir d’un bistrot.
À ce stade (et nous n’en sommes qu’au prologue !) le lecteur est prévenu : ce livre donne la part belle aux idées reçues, même si, avec un peu de bonne volonté, on continuera à se convaincre que le message est bien mal tourné. Mais si le lecteur peut accepter des à-peu-près qui rendent justice à la volonté d’ouverture d’esprit de l’essayiste, celui-ci ne fait rien pour sauver sa cause :
« Dès le tout début de mon travail avec eux, j’ai été frappé de voir [les Néo-Guinéens] en moyenne plus intelligents, plus éveillés, plus expressifs et plus intéressés par les choses et les gens de leur entourage que l’Européen ou l’Américain moyen. » (p. 8)
Jared Damond, on le voit, aime invoquer les « moyennes », et n’a aucune difficulté à tirer de son expérience personnelle des généralités qui concernent, excusez du peu, l’intelligence, l’éveil, l’expressivité et l’intérêt pour les choses de populations aussi vastes (et aussi disparates) que l’Européen et l’Américain moyen.
Examinons ces dernières citations : si, au lieu de mentionner les « populations industrialisées », les Américains ou les Européens, Diamond avait choisi de parler des Africains, par exemple, qui ne songerait pas que ces pensées sont scandaleuses ? Est-ce bien la peine de se déclarer ouvertement opposé au racisme pour écrire avec une complaisance gourmande des mots si fades, et si contraires à la common decency ? On se prend à douter de la valeur intellectuelle d’un professeur émérite.
Diamond avance cependant un semblant d’explication :
« Presque toutes les études sur le développement de l’enfant insistent sur le rôle de la stimulation et l’activité au cours de la petite enfance dans le développement mental, et mettent en évidence le retard mental irréversible associé à des stimulations réduites dans l’enfance. Cet effet explique certainement une part non génétique de la supériorité mentale moyenne des Néo-Guinéens. » (p. 10)
Encore une moyenne ! Cette « supériorité mentale moyenne » n’est naturellement pas démontrée, et rend aléatoires, disons, les inférences que l’on penserait pouvoir tirer de ce fait. Quant à l’hypothèse de la « stimulation de l’activité dans la petite enfance », elle ouvre plus de portes
qu’elle n’en ferme. Qu’en est-il de cette stimulation parmi les Guajajara du Brésil ? Ce peuple amazonien est-il mentalement supérieur, en moyenne, à celui des Néo-Guinéens ? Plus intelligent ? Ou bien ces indigènes sud-américains sont-ils moins éveillés, moins expressifs que leurs lointains contemporains de Nouvelle-Guinée ?
Ces questions-là sont stupides et sans grand sens, en plus d’être fondamentalement dérangeantes ? Certainement. Pourtant, Diamond invite ses lecteurs à les prendre au sérieux.
 |
| Michael Moore : Mike contre-attaque ! (Stupid White Men and other Sorry Excuses for the State of the Nation) (c) La Découverte, 2001 |
Disons-le encore. L’auteur, on veut le croire, joue la provocation, souhaite heurter le « Blanc », le « civilisé » en déclarant son intérêt pour des sociétés différentes et, estime-t-il avec raison, considérées par certains comme « inférieures ». L’objet de son propos est légitime. Ce sont les mots employés, et sa méthode, qui ne le sont pas. La logique bancale de son approche est identique à celle de Michael Moore dans Stupid White Men et, si l’on pouvait hausser les épaules devant la prose outrancière du gauchiste américain, il est inquiétant de la trouver dans le si célébré Guns, Germs, and Steel. Et il est encore plus douteux de le voir brasser avec tant d’aisance les concepts de « Blancs », de « Noirs » et d’autres « groupes » d’hommes pour asseoir sa réflexion, embrassant de ce fait un principe essentialiste. Il s’en explique page 383 : « Regrouper des populations aussi différentes que les Zoulous, les Somalis et les Ibo dans la même catégorie des “Noirs”, c’est faire fi de tout ce qui les distingue. » En effet ! Il continue :
« Nous négligeons également des différences de taille en assemblant les Égyptiens d’Afrique et les Berbères mais aussi en inscrivant les Suédois dans la catégorie des “Blancs”. De surcroît, les divisions entre Noirs, Blancs et autres grands groupes sont arbitraires car ces groupes se fondent les uns dans les autres : des membres de chaque groupe se sont accouplés avec des membres des autres groupes qu’ils ont rencontrés. »
Toutes ces précautions de langage sont bienvenues, mais restent rhétoriques, car l’auteur finit par conclure que « cette réserve faite, notre classification en grands groupes demeurant néanmoins utile pour comprendre l’histoire, je m’y tiendrai donc. »
Et donc, le lecteur sait qu’il a sous les yeux le texte d’un homme conscient des insuffisances qu’il profère. Il prendra la suite de l’essai avec d’infinies précautions — c’est bien le moins qu’il puisse faire au vu des errements offerts par cet inquiétant prologue.
Cajamarca, 1532
L’interrogation revient avec obstination dans l’essai, car elle illustre le thème fondamental : pourquoi l’Europe a-t-elle pu conquérir si vite l’Empire des Incas ? La réciproque — des armées sud-américaines débarquant dans l’Espagne de la Renaissance, et lui imposant son joug — aurait-elle été possible ? Le point crucial est la capture d’Atahualpa par Pizarre et les siens au terme du carnage de Cajamarca.
L’essayiste, après avoir retracé les faits, pose la question, et y répond sans apporter de révélations : chevaux, technologie des armes à feu, alliés locaux qui se retournèrent contre leur maître et précipitèrent l’effondrement des Quechuas. Tout cela est connu et rien ne vient ici éclairer d’un jour nouveau l’histoire.
Il est cependant permis d’insister sur un fait de la plus haute importance, que Diamond se refuse à mettre en évidence. Les autochtones étaient pétris de superstition. Le récit de la capture de l’empereur par Pizarre est éloquent. Alors que la bataille faisait rage sur une esplanade rougie par le sang, l’une des plus grandes préoccupations des Quechuas, loin d’organiser leur défense contre l’agresseur, était de maintenir à l’écart du sol la litière où se tenait l’empereur. Que l’un des porteurs périsse, un Indien accourait pour prendre sa place. Protéger son souverain au cœur du combat est un acte héroïque et nécessaire, toutefois ce n’est pas exactement ce qui se produisit : plutôt que de mettre Atahualpa à l’abri, et d’envisager une riposte dans l’urgence, les Incas œuvraient pour que sa litière ne cesse d’être portée. On trouve assurément ici l’expression d’une superstition qui prenait le pas sur l’esprit pratique.
Bien entendu, l’Européen aussi avait ses croyances et ses fétichismes, mais ceux-ci ne tenaient semble-t-il pas le même rang dans son expérience du monde. Les conquistadores mal dégrossis ne brillaient pas par leur finesse d’esprit, et Pizarre lui-même, enfant d’une Estrémadure déshéritée, ne savait sans doute pas lire. Cependant leur épopée s’inscrit dans celle plus vaste d’une civilisation européenne, porteuse d’histoires séculaires d’empires triomphants puis défaits, de chroniques immémoriales de guerres et de ruses. La Reconquista venait de s’achever. Au poids des mythes s’opposaient ceux des sciences et d’une philosophie qui lentement se départait de l’emprise religieuse. La conquête du Pérou est contemporaine de la première édition du Prince de Machiavel, du Gargantua de Rabelais, de l’Orlando furioso de l’Arioste. On en chercherait en vain le pendant outre-Atlantique. L’histoire des hommes, là-bas, était différente ; et si beaucoup d’entre eux périrent à cause des germes, gardons en mémoire que leur propre culture ne les immunisait nullement contre les mille stratagèmes de l’art de la guerre, tels qu’ils vivaient dans l’âme des guerriers de l’Ancien Monde.
 |
| Concepción Bravo : Atahualpa (c) Historia 16 / Quorum 1986 |
Quand Pizarre captura Atahualpa, l’empire Inca sortait d’une terrible guerre civile. Diamond la présente en ces termes :
« La raison de la guerre civile était une épidémie de petite vérole qui se répandit parmi les Indiens d’Amérique du Sud après son arrivée avec les colons espagnols à Panama et en Colombie. Autour de 1526, elle avait terrassé l’empereur inca Huayna et la majeure partie de sa cour, puis son héritier désigné, Ninan Cuyuchi. Ces morts précipitèrent une guerre de succession entre Atahualpa et son demi-frère, Ninan Cuyuchi. Sans l’épidémie, les Espagnols auraient dû affronter un empire uni. »
Il est permis de hausser les sourcils. On ne sait pas exactement quelle maladie terrassa Huyana Capac, sa cour et son héritier, même si la petite vérole est un candidat sérieux. L’essentiel est ailleurs : l’empire inca était un jeune géant aux pieds d’argile. Jeune, car les historiens actent son apparition autour de 1438 (bataille de Yahuar Pampa) — moins d'un siècle avant la fatale rencontre avec les Espagnols. C’est dans ces années que naît Martín Alonso Pinzón, futur capitaine de la Pinta. Fragile : son expansion fulgurante, touchant le Chili et la Colombie, encourageait l’essor sur son immense
territoire de baronnies contestataires. La très violente confrontation entre les deux prétendants, Atahualpa et Huascar, est une conséquence logique d’un éclatement annoncé : le premier est associé à l’empire du nord, à peu près l’Équateur actuel, tandis que le second tenait sa légitimité de la capitale péruvienne Cuzco. La disparition de Huyana et de son « successeur désigné » déclencha une guerre civile qui couvait, attisée par le ressentiment des peuplades asservies. Seule une volonté farouche de servir la thèse de Diamond fait apparaître dans l’équation une épidémie venue d’Europe. Que Huyana et son successeur potentiel soient morts de vérole, de rougeole ou d’une quelconque autre cause n’a en l’espèce aucune importance pour le déroulement des faits. La maladie n’a pas décimé les rangs incas suite à la bataille de Cajamarca : de ce point de vue, les armées autochtones étaient intactes. Les troupes du nord dirigées par le général Rumiñahui étaient même restées en réserve, à l'écart des combats contre Cuzco. L’hécatombe due aux microbes arrivera plus tard, quand la cause était déjà entendue.
Si le « choc des civilisations » qui eut lieu à Cajamarca est emblématique, l’événement reste un symbole. Même sans ce carnage et la naïveté d’Atahualpa, on ne voit guère comment l’empire inca aurait pu résister longtemps aux forces européennes, mieux équipées et instruites par la récente conquête du Mexique. La bataille entre le pot de terre et le pot de fer était trop inégal, d’un strict aspect militaire. On est tenté de suivre Diamond quand il explique comment les hommes, de part et d’autre de l’océan, étaient arrivés à la situation qui était la leur au début du XVIe siècle, et notamment dans sa description des progrès de la domestication, et pointant l’absence de bêtes de trait dans le Nouveau Monde. Ces pages retiennent l’intérêt et séduisent l’esprit, quand bien même on ne saurait juger de leur valeur objective.
La Nouvelle-Guinée, centre du monde
Un lecteur de la planète Mars penserait, à lire cet essai, que l’histoire du monde s’est créée autour de celle de la Nouvelle-Guinée. Le nom de ce pays apparaît 300 fois, et à 149 reprises l’essayiste nous parle de Néo-Guinéens. Presque 450 occurrences — à peu près une par page. L’explication est simple : M. Diamond a vécu dans cette île et y a forgé, selon ses dires, de solides amitiés. On veut bien le croire. De même qu’on croirait avec raison que l’auteur d’un travail rigoureux doit être capable de laisser de côté ses passions personnelles pour se vouer à l’objet de sa thèse : en l’espèce, le recours constant aux anecdotes ou observations relatives à ce pays n’apporte pas grand-chose à la trame argumentaire du récit.
La remarque vaut pour la plupart des chapitres, échafaudés autour de rappels historiques, ou relatifs à l’histoire naturelle, ou à l’évolution des systèmes d’écriture, qui s’étalent sur de longues pages, sans qu’ils ne contribuent en rien à l’architecture logique du récit. Pour le dire autrement, les retirer ne modifierait nullement le propos général. Ce remplissage n’est pas sans intérêt, mais c’est du remplissage. L’auteur parsème sa rédaction de questions, qu’il lui appartient d’élucider, sans y parvenir toujours. Or, c’est à la lumière des prémisses et des inférences que le lecteur doit pouvoir se forger une opinion.
Plutôt que se consacrer à cette tâche, Diamond s’emploie à décrire la supériorité intellectuelle de nations lointaines.
« Il y a des Edison en puissance parmi les Néo-Guinéens que je connais. Mais ils ont consacré leur ingéniosité à des problèmes techniques appropriés à leur situation : ceux que posent la survie sans possibilité d’importation en plein cœur de la jungle plutôt que ceux de l’invention de la photographie. » (p. 255)
Pourquoi pas. Ce sont là des réflexions personnelles, admettra-t-on, que rien ne vient étayer. Toutefois, Diamond aurait gagné en précision en reconnaissant que l’inventeur de la photographie (qui n’était pas Edison) a rendu service au genre humain, à la différence du génie apprenant comment survivre dans la jungle.
La fascination pour la Nouvelle-Guinée reflète çà et là une mise en perspective de la civilisation, en tant que telle, et surtout de celle née en Europe. Ainsi, l’essayiste nous apprend incidemment que le… Coran est l’un des « piliers moraux » de la civilisation occidentale :
« Il se pourrait donc bien que ce soit l’Afrique qui ait donné naissance aux langues parlées par les auteurs de l’Ancien et du Nouveau Testament et du Coran, piliers moraux de la civilisation occidentale. » (p. 387)
Ce passage n'étonnerait pas dans une de ces productions Netflix qui font la part belle à la « diversité », quitte à tordre la réalité historique afin de mieux complaire à un certain public. Mais est-il possible qu’une telle chose ait été écrite dans un ouvrage sérieux, ait passé l’épreuve des relectures et de l’examen éditorial ? La réponse, hélas ! est « oui ».
 |
| Queen Cleopatra (c) Netflix |
On appréhende de trouver ici le récit d’un homme confortablement installé en Californie et qui croit bon de vanter les mérites des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Cette vision imbibée de rousseauisme se retrouve à divers endroits. Par exemple, page 107 :
« Au cours de la dernière décennie du siècle, [les rares peuples restés chasseurs-cueilleurs] auront eux aussi cédé aux attraits de la civilisation, se seront établis sous la pression de bureaucrates ou de missionnaires, ou auront succombé aux germes. »
Des bureaucrates, des missionnaires, des germes, quel triste sort pour ces peuples voués à « céder aux attraits de la civilisation ». C’est entendu, mais le doute est permis. Et si le « bon sauvage » désirait lui aussi profiter du confort moderne et tirer parti de ce que cette maudite civilisation de bureaucrates et de missionnaires pourrait lui offrir ? De plus, n’est-ce pas auprès d’elle qu’il pourrait précisément trouver protection contre ces « germes » qui obsèdent tant M. Diamond ?
C’est que, fidèle à une certaine tradition d’antiracisme — qui, depuis lors, a fait florès — M. Diamond se garde bien d’attribuer à ceux qu’il appelle « les Blancs » une quelconque supériorité morale ou intellectuelle. La question qu’il pose au sujet de l’Australie est révélatrice :
« Quand on les interroge sur l’“arriération” culturelle de la société aborigène, beaucoup d’Australiens blancs ont une réponse simple : les insuffisances supposées des aborigènes eux-mêmes. » (p. 292)
Quelques lignes plus bas, on lit :
« Le continent était le même, seules les populations étaient différentes. En conséquence, l’explication des différences entre société indigène et société européenne d’Australie doit se trouver dans la nature des différentes populations qui les composent. La logique de cette conclusion raciste paraît irrésistible. Nous allons voir qu’elle pèche cependant par une erreur grossière. »
Suivent plusieurs pages consacrées à l’histoire de l’Australie, à la comparaison des sociétés aborigène et néo-guinéenne, avant qu’enfin nous sachions la réponse apportée à cette « conclusion raciste » :
« N’aurait-on pas là, s’agissant de l’évolution des sociétés humaines, une expérience parfaitement contrôlée nous obligeant à en tirer des conclusions racistes élémentaires ? Le problème est simple. Les colons européens n’ont pas créé en Australie une démocratie industrielle, productrice de vivres et alphabétisée. Tous ces éléments, ils les ont importés de l’extérieur. » (p. 314)
Suit une énumération (il serait intéressant de savoir combien d’énumérations sont présentes dans ce livre, et si leur répétition apporte quoi que ce soit) de ces éléments importés, « produits finis, fruits de 10 000 ans de développement dans des milieux eurasiens. » Cette révélation enchantera les enfonceurs de portes ouvertes. Dommage que Diamond n’aille pas au bout de l’évidence qu’il a ingénument prononcée : ces « produits finis » issus de millénaires de perfectionnement dans des milieux eurasiens ne sont-ils pas intimement liés à la population occidentale qui s’établit en Australie ?
La réponse qu’il apporte n’en est pas une : elle renvoie aux fondements même de la question initiale, celle qui pourtant était qualifiée de « raciste » en plus de « pêcher par une erreur grossière ». L’erreur consisterait à assigner aux aborigènes une intelligence inférieure à celle des Blancs, mais non à pointer les différences dans l’organisation de leurs sociétés respectives. Diamond précise : « Les Européens n’ont jamais appris à survivre en Australie ou en Nouvelle-Guinée sans la technologie eurasienne. Robert Burke et William Wills étaient assez intelligents pour écrire, mais pas assez malins pour survivre dans le désert australien où vivaient des aborigènes »
Burke et Wills, pionniers blancs, ont péri dans leur exploration du continent, en 1861, et on laissera le soin aux érudits de décréter si ces explorateurs étaient des malins ou des crétins. Peu importe : l’auteur nous dit ici que les aborigènes pouvaient vivre dans le désert australien, sans technologie eurasienne. En d’autres termes, il pointe bien dans cette société, ne lui en déplaise, une nature différente de celle des Blancs — nature civilisationnelle, bien entendu, et non des individus considérés sous l’angle biologique. Il n’est pas assuré que les « Australiens blancs » coupables de pensées racistes aient en vérité une opinion autre.
Appels à la nature et autres errements
On n’est pas étonné de lire, sous la plume de ce progressiste, un insolite appel à la nature :
« Un amuse-gueule d’amandes amères peut tuer une personne assez sotte pour passer outre l’avertissement de l’amertume. » (p. 112)
Amateurs de pamplemousses, buveurs de bière IPA, vous voilà prévenus, sots que vous êtes. Mère nature, Gaïa toute-puissante, ne nous dit-elle pas que l’amertume est un signal d’alerte ?
Cet essai qui valu à son auteur le prix Pulitzer en 1998 présente d’autres étonnantes erreurs. Page 252, Diamond parle de la Tchécoslovaquie moderne, ce qui suppose une méconnaissance flagrante de la marche du monde. Ou encore, page 71, il discourt sur la guerre civile entre « Atahualpa et son demi-frère, Ninan Cuyuchi ». Le pauvre Ninan Cuyuchi mourut de fait avant le déclenchement de la guerre civile inca — et, pour cause, sa disparition hâta la catastrophe. L'essai compte aussi de curieuses tentatives de faire de l’humour quand, page 332, son auteur narre « une situation du plus haut comique » avec des mots qui persuaderaient un suicidaire de passer à l’acte.
Il sous-estime le rôle de la civilisation et de ce qu’elle comporte dans l’établissement de l’inégalité entre les sociétés. Page 255 : « L’avantage initial considérable de l’Eurasie s’est ainsi traduit par une très grande avance en 1492 — pour des raisons qui tiennent davantage à sa géographie particulière qu’à l’intelligence des hommes. » La géographie n’explique pas tout, et cette explication commode est à elle seule fausse. C’est l’auteur lui-même qui le dit, car on lit p. 419 : « Contrairement à la Chine, l’Europe n’a jamais eu de despote capable de tout verrouiller. » Ce dernier point est déterminant. L’absence de centralisme européen s’est manifestée par une mise en concurrence des nations, quand la Chine se referma sur elle-même en 1433 et renonça aux grandes expéditions maritimes.
Le constat induit autre chose. Le récit de l’inégalité entre les sociétés, commencé dans la nuit des temps, rejoint immanquablement l’actualité récente, à l’échelle des millénaires. La métahistoire est remplacée par la bonne vieille histoire, avec ses faits politiques et ses bouleversements. L’ambition initiale de l’essayiste s’en trouve contrariée, car la conclusion finale ne serait-elle pas celle que la richesse des nations procède de l’intelligence des systèmes politiques ? La géographie a bon dos : explique-t-elle les différences entre RFA et RDA ? Entre les deux Corées ? Entre le Botswana et le Zimbabwé ?
Les bienfaits de l’humanisme (liberté, démocratie, lutte contre les croyances) n’apparaissent pas clairement dans les éléments brassés dans l’essai — pour ne pas dire jamais. Ces phénomènes n’intéressent pas l’auteur, qui se donne le luxe de les maltraiter. Il est très révélateur et très préoccupant que Diamond livre sans sourciller page 266 une réflexion effrayante :
« Entre un kleptocrate et un homme d’État avisé, […] il n’y a jamais qu’une différence de degré : tout dépend du pourcentage du tribut prélevé sur le peuple et conservé par l’élite et du regard que porte le peuple sur les usages publics auxquels est affecté le tribut redistributif. »
Cette phrase est invraisemblable. Elle fait fi du système politique dans lequel évolue l’homme d’état : l’état de droit, précisément, encadre le pouvoir des dirigeants, et si ce pouvoir nous paraît aujourd’hui excessif, c’est que les contre-pouvoirs fonctionnent mal. Et le dirigeant avisé, nous enseigne l’examen des faits politiques du dernier siècle, est bien davantage celui qui laisse la liberté à ses administrés que celui qui les tient par la contrainte. Le « tribut redistributif » dont parle Diamond n’est autre que la « part du gâteau » qu’il faudrait trancher à parts égales, selon une hérésie familière aux étatistes dont l’auteur semble se faire un héraut.
L’écrivain, sur sa lancée, compare sans désemparer Mobutu à… George Washington :
« Le président Mobutu de l’ex-Zaïre (aujourd’hui Congo) nous apparaît comme un kleptocrate parce qu’il thésaurisait à l’excès le tribut (l’équivalent de milliards de dollars) et ne le redistribuait guère. Mais nous tenons George Washington pour un homme d’État parce qu’il consacra l’argent des impôts à des programmes suscitant l’admiration et qu’il ne s’est pas enrichi à la faveur de ses fonctions présidentielles. »
C’est expéditif, provocateur, et faux : Washington, benoîtement dépeint en brave épicier décidant de l’allocation des impôts, était l’un des pères fondateurs de la constitution américaine, dans l'héritage philosophique des Lumières. Le tyran du Zaïre cultivait quant à lui une politique institutionnelle de pillage et de corruption. Comparer les deux hommes dans une optique de « différence de degré » n’est pas simplement une ânerie : c’est une insulte à l’intelligence.
Cela ne compte guère pour Diamond, qui se paye de mots et lance de dernières piques édifiantes :
« Il n’en est pas moins né fortuné, dans un pays où la richesse est beaucoup plus inégalement distribuée qu’elle ne l’est dans les villages néo-guinéens. »
Diamond, on le voit, cuisine ici la tarte à la crème de la répartition inégale des richesses, tout en pointant innocemment le fait que Washington, quelle horreur, soit « né fortuné ». À se demander dans quel sommeil profond un si éminent intellectuel était plongé quand le mur de Berlin fut détruit !
Comment vouloir porter à la face du monde une histoire commencée à l’aube de l’humanité, quand on n’est pas capable de tirer le bilan des dernières décennies ?
Épilogue. Un livre pré-wokiste ?
Lisons ce passage de la page 429 :
« Bien que la plupart des biologistes admettent que les systèmes biologiques sont en définitive entièrement déterminés par leurs propriétés physiques et obéissent aux lois de la mécanique quantique, la complexité des systèmes signifie dans les faits que la causation déterministe ne se traduit pas en prédictibilité. La connaissance de la mécanique quantique n’aide pas à comprendre pourquoi des prédateurs placentaires introduits ont exterminé tant d’espèces australiennes de marsupiaux ni pourquoi ce sont les Alliés, plutôt que les Puissances centrales, qui ont gagné la Première Guerre mondiale. »
Ce sont là de bien grands mots, et de bien curieuses méthodes, pour décrire une plate évidence. En effet, l'histoire n'est pas une science, et la mécanique quantique ne permet pas d’expliquer la victoire des Alliés en 1918. Pas plus que la science mycologique, précisons-le à l’attention des étourdis. La mécanique quantique n’a rien à faire dans ce galimatias, sauf à vouloir éblouir le gogo. Du reste, l’auteur sous-entend que la physique quantique autoriserait une approche déterministe, ce qui est une jolie perle. Voilà ce qui se passe quand on emploie des mots sans maîtriser les concepts qui en découlent. Ce procédé renvoie aux pires charlatans s’efforçant de fourguer leur pacotille. On souffrirait d’inscrire M. Diamond, certainement un homme très sympathique et bienveillant, au bas de la longue liste des imposteurs médiatiques. Force est de reconnaître que l’accumulation des approximations et des erreurs factuelles ne permet pas d’éloigner cette éventualité.
Ne soyons pas injustes. On retiendra de ce livre des réflexions intéressantes et un panorama de l’histoire humaine par endroits original en dépit de certains accrocs, en partie exposés plus haut. Cependant, on notera aussi que plusieurs de ses thèmes « indigénistes », relativistes et antilibéraux ont, ces dernières années, pris une importance démesurée en Amérique du Nord et dans l’Europe de l’Ouest, avec leurs terribles corollaires brutaux et antisémites. Cet essai de 1997 apparaît de temps à autre comme un manifeste wokiste avant l’heure, et légitimé en cela par le prestige de son auteur et l’accueil du public. Peut-être sera-t-il même étudié comme un ouvrage précurseur, si l'Université parvient à sortir honorablement des turbulences actuelles.
Un dernier mot : à plusieurs reprises, l’essayiste s’aventure dans la fiction historique. Page 404, il énonce : « Des troupes de choc bantoues chevauchant des rhinocéros auraient pu venir à bout de l’Empire romain. »
Oui, elles l'auraient pu, surtout si elles avaient revêtu leurs rhinocéros de cuirasses d’uranium appauvri — tant qu’à faire de l’uchronie, pourquoi ne pas aller au bout ? Fort heureusement, Diamond prend le soin d’ajouter aussitôt : « Cela ne s’est jamais produit. » Cette précision montre l’intelligence qu’il prête à ses lecteurs. Peut-être n’a-t-il pas tort, après tout, au vu des louanges qui accompagnèrent la sortie de Guns, Germs, and Steel.
Alain CF, décembre 2023
Références
Jared Diamond, De l’inégalité parmi les sociétés — Essai sur l’homme et l’environnement dans l’histoire (Guns, Germs, and Steel. The Fates of Human Societies). Traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat. Éditions Folio Essais.
Pour l'histoire d'Atahualpa, se référer par exemple au livre de Concepción Bravo cité plus haut.